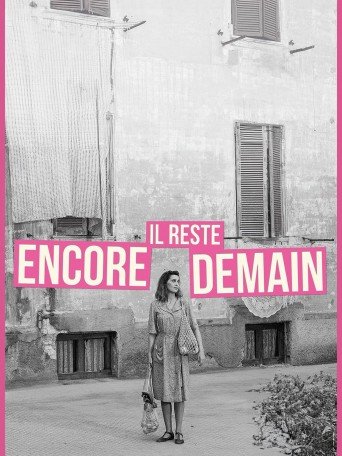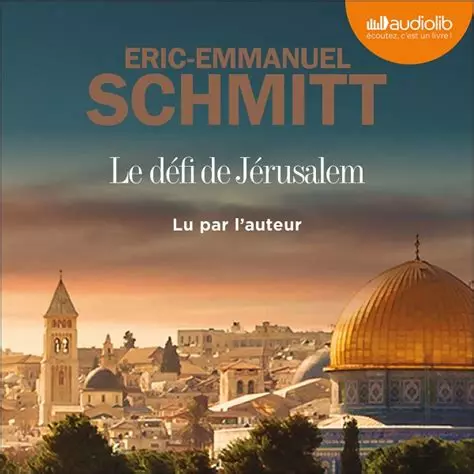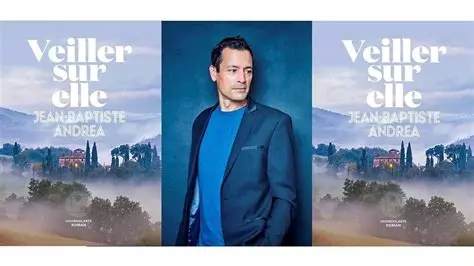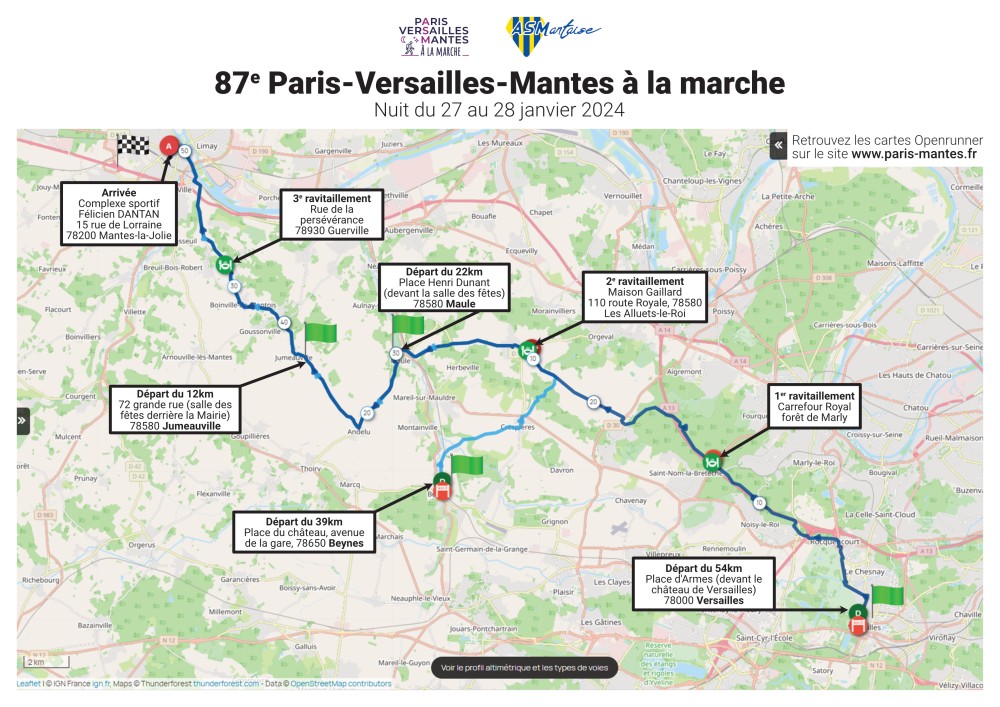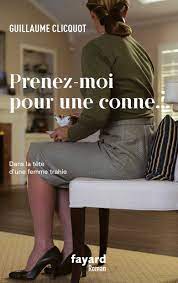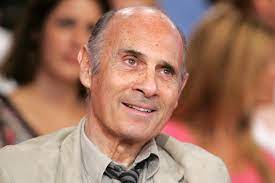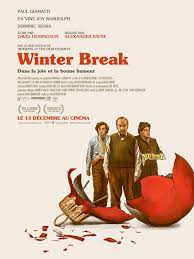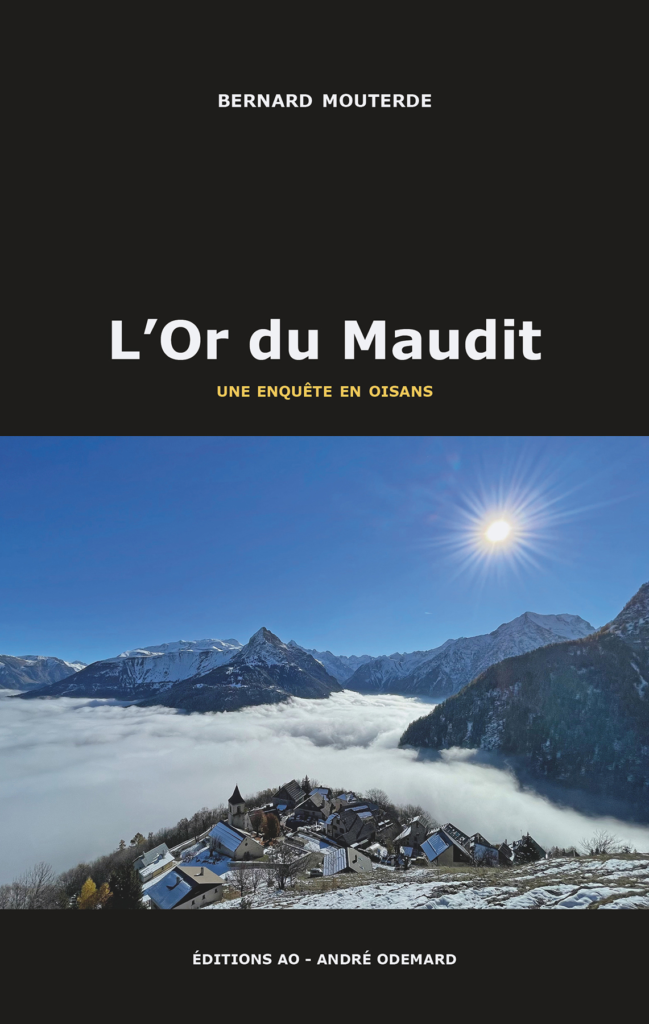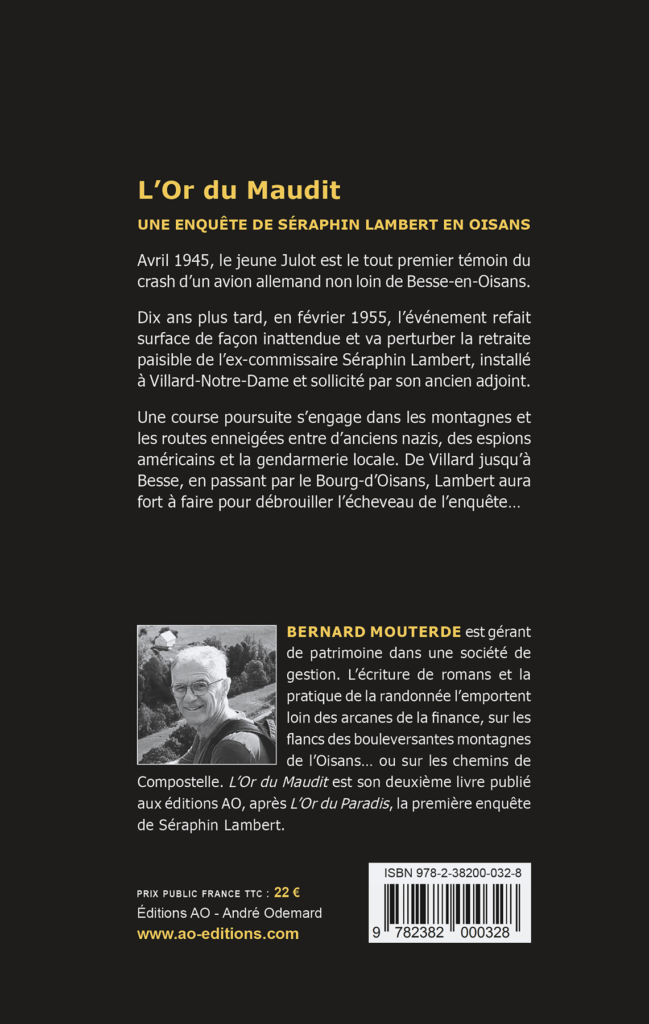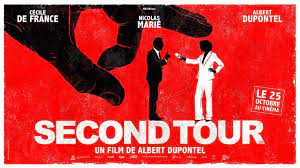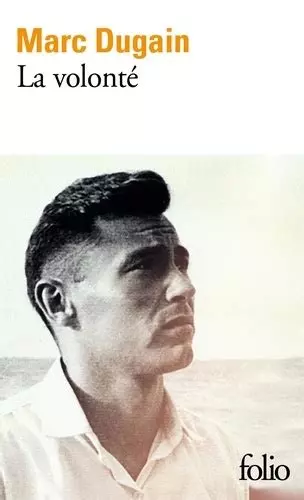Le film est du réalisateur Stéphane Brizé, mais c’est un film que Guillaume Canet aurait pu faire, tellement il lui ressemble. L’exploration des troubles et des tensions liés à chaque âge est du « pur Canet » dans le texte et les motivations. Cette fois-ci, ce n’est pas une bande de potes trentenaires comme dans « les Petits Mouchoirs », mais les questionnements métaphysiques de la cinquantaine, quand l’âge se fait sentir et qu’il provoque chez les perfectionnistes comme l’est notre fringant acteur, des sentiments dépressifs.
Voilà donc un film au public ciblé qui ne passera pas le filtre des plus jeunes. Et pourtant quelle justesse de ton !… Le film est lent, laborieux, plein de moments de silence; la Bretagne y est austère, peu engageante. Matthieu, notre dépressif a choisi l’endroit le moins naturel pour se ressourcer. D’ailleurs, son séjour de Thalasso est marqué par l’ennui et un détachement à toute épreuve… Les images s’étirent dans un grand bâillement du spectateur. Jusqu’à l’arrivée du personnage d’Alice ( Alba Rohrwacher merveilleuse de justesse ), une ancienne maitresse abandonnée qui apparaît comme un rayon de soleil dans un ciel d’orage. Tout s’articule ensuite autour de cette femme, pudique, peu sûre d’elle, qui brave les souvenirs douloureux du passé pour retisser du lien. Face à elle, il reste mutique, peu ouvert, mais se laisse finalement séduire par la générosité de cette femme qui fait du bien dans un hospice de vieux. Elle l’invite dans la célébration d’un mariage entre deux résidents de la maison, autour d’une soirée où les yeux du dépressif retrouvent l’étincelle de la vie. La soirée est d’une grande puissance émotionnelle, comme le témoignage d’une vieille femme, passée à côté de sa vie, et bien décidée à rattraper le temps perdu.
Comme l’espérait le spectateur, les deux amants finissent par se retrouver pour une étreinte qu’on imagine furtive. Ainsi, c’est dans un pays hostile, entouré de vieux proches de la fin, que Matthieu va retrouver une certaine envie de vivre. Alice n’en sortira pas indemne, car le mal-être peut sauter d’un individu à l’autre. Foutue déprime des bilans quinquagénaires !… Finalement, seul l’amour est un ciment qui tient pour traverser ces moments difficiles.
Un beau film, léger, et sans doute pas tous publics. Qu’importe, l’esprit est là, et il parlera à beaucoup…