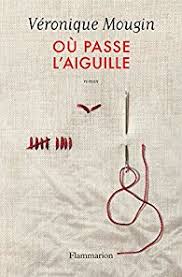« Où passe l’aiguille » : le titre m’a troublé; je n’arrivais pas à m’en souvenir; je n’en voyais pas la signification; je ne le trouvais pas très accrocheur… Jusqu’à ce que je lise la dernière page qui m’a donné la clef. La clef d’un récit subtil, écrit par une jeune femme, Veronique Mougin, qui y a mis tout son coeur.
Je n’ai pas lu la 4eme de couverture avant de lire ce livre, et cela a été donc une expérience. Expérience précieuse car le passionné d’histoire que je suis, y a trouvé son miel avec l’évocation de cette famille hongroise juive connaissant en 1943-1944 le rejet par ses voisins, la soumission aux autorités, l’espoir vain d’une rémission, puis l’enfer des camps de concentration. Plus j’avançais dans l’histoire, plus j’admirais cette jeune auteur d’avoir su, de nos jours, rentrer dans la psychologie des déportés de Dora et de Bergen-Belsen. La lente dégradation physique, l’instinct de survie, le repli sur soi et sur un petit groupe immédiat, la débrouille insensée, le gain de chaque jour comme une victoire sur l’inéluctable… Tout cela est décrit avec une précision chirurgicale, des détails foisonnants, une identification bluffante, d’autant que, point primordial, le livre est décliné à la première personne du singulier. La personne d’un jeune garçon qui se bat pour survivre… Quelle gageure !
Les pages sont bonnes, l’écriture relevée, les images troublantes… Mais c’est un récit dur qui n’épargne guère le lecteur. D’autant qu’il y a quelques maladresses d’écriture qui m’ont agacé, comme cette habitude d’émailler le récit linéaire de digressions en italiques pour retranscrire les pensées de personnages secondaires. Cela coupe la narration et gêne l’intrigue car tous les protagonistes de l’histoire deviennent transparents.
Le jeune Tomi survit au camp. La couture qui l’a fait survivre, devient son seul univers. Il n’a avec lui plus que son père, un tailleur besogneux. Tous les autres sont morts, happés par la folie nazie. Il sera donc couturier, et même un grand couturier. La seconde partie du livre parle donc de cette carrière, et là paradoxalement, Veronique Mougin semble un peu moins à l’aise à parler de mode et de chiffon que du désespoir des camps. Enfin, soyons honnête, c’est tout relatif car elle étincelle, en fin de livre, dans la description de la préparation d’une collection de haute couture. Véronique Mougin sait parfaitement bien saisir la folie du créateur et la fièvre qui s’empare de toutes les petites mains de la maison de couture. Là encore, l’auteur est parfaitement renseigné et nous fait entrer dans le sérail avec une très belle écriture.
Je me suis senti pourtant un peu déçu car le récit manque de dynamique. Pas de ligne directrice… Ou veux-t-elle en venir ? Le roman se délite, le lecteur reste sur sa faim… Et puis tout s’éclaire avec les cinq dernières pages. Ce livre n’est pas un roman, c’est un récit familial, l’histoire intime d’un cousin qui s’exprime non plus en personnage, mais en protagoniste principal de l’histoire. De son histoire. L’émotion prend alors le relais. Toutes les faiblesses romanesques n’en sont plus dans ce qui devient la chronique d’un destin. Une vie n’a pas d’épilogue, pas de dénouement littéraire. C’est la vie, un point c’est tout…
On éprouve du coup une très grande bienveillance vis à vis de ce travail de mémoire. Raconter l’histoire d’ancêtres restés silencieux sur leur passé est un exercice qui nous a tous un peu démangés. Pour leur rendre grâce. Pour mettre en valeur un destin exceptionnel. Pour laisser une trace de leur passage.
Véronique Mougin le fait avec grand talent, avec un récit qui cache son jeu, mais qui est d’une grande justesse. Ce livre mérite le détour, assurément…