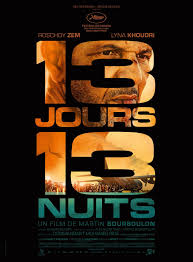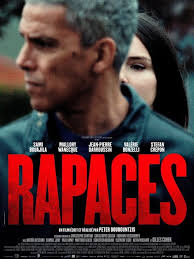Au générique de fin, j’étais heureux et je me disais « quelle grâce que ce film ! » avant de réaliser que c’était le nom du film en italien. Une grâce qu’il faut donc prendre au sens propre, avant la grâce présidentielle accordée à des prisonniers dont il est question dans le récit.
Paolo Sorrentino, le réalisateur, a une griffe bien à lui dans ses images très léchées et dans une ambiance décalée qui exulte le bonheur de vivre. Et la douceur de vivre à l’italienne… Il aime souvent émailler son récit d’images hypnotiques de danseurs et de quelques incongruités humoristiques ( comme ce rap inattendu entonné par le Président ).
J’avais adoré « la Grande Bellezza » ( 2013 ), film qui m’avait beaucoup marqué et qui, à mes yeux, est le summum de l’art de vivre à l’italienne. Ici, avec le même acteur Tony Servillo qui a la présence charismatique d’un Marcello Mastrioanni, le récit d’un vieux président sur le départ est savoureux. Nous sommes en Italie, et le rôle est surtout honorifique. Mais quel plaisir que ces inaugurations de chrysanthèmes, notamment ce dîner d’anciens militaires !
L’histoire est hachée, déstructurée, sans autre fil directeur que de nous faire vibrer sur des images. Nous sommes dans la ouate, un liquide amniotique de bonheur, avec un président qui n’est pas dans l’action, mais dans la réflexion. Et dans la nostalgie face à la perte de sa femme…
Paolo Sorrentino sait jouer comme personne avec les silences ; il s’appuie, il est vrai, sur un acteur extraordinaire qui est un stradivarius d’émotions. Il nous fait un nouveau film extrêmement humain et touchant. A voir bien sûr dans une langue italienne qui est la colonne vertébrale du cinéma de Sorrentino… Il me tarde de voir les films que j’ai loupés dans sa filmographie.