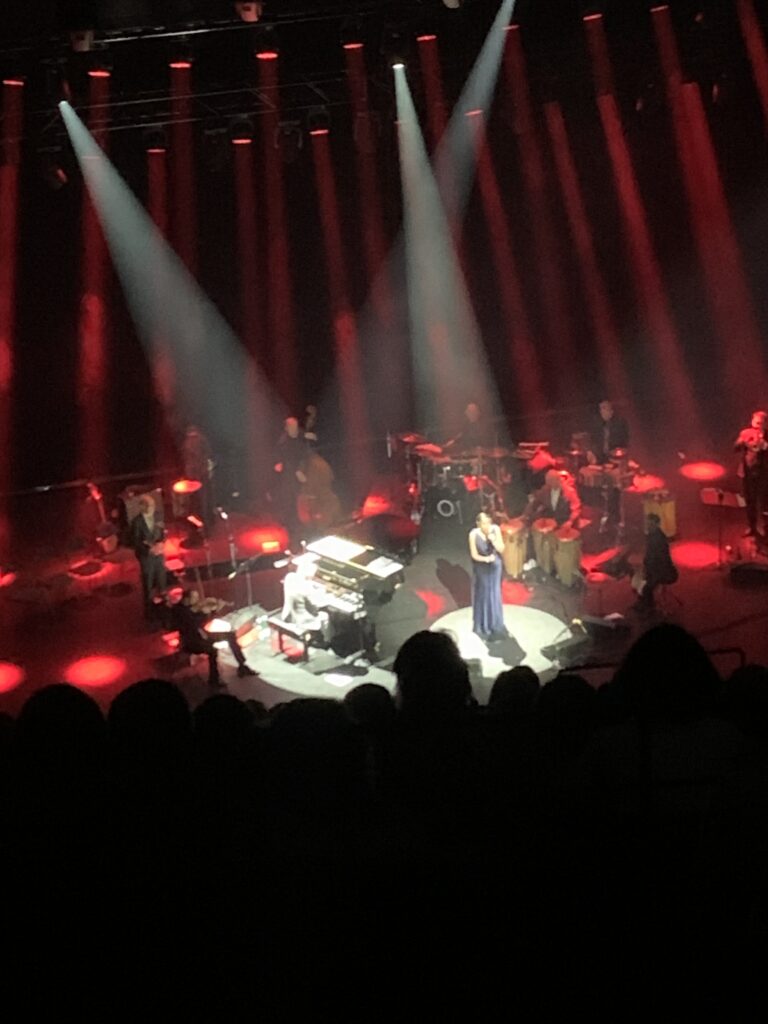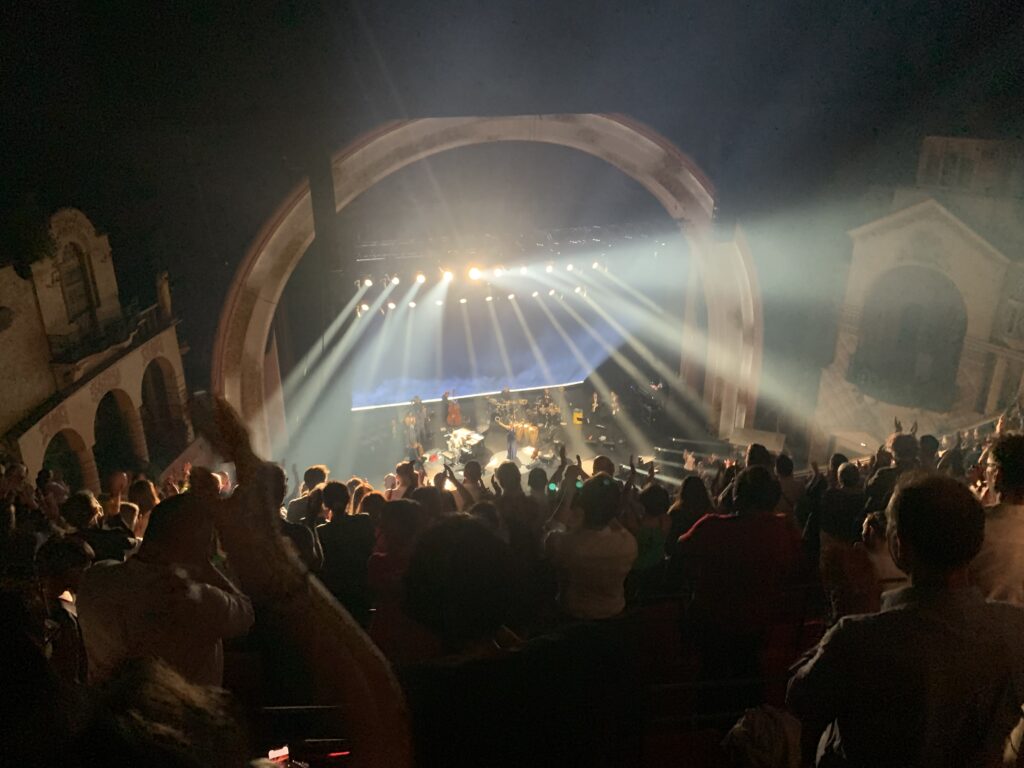J’ai failli passer à côté de ce film. La sortie intempestive de Justine Triet la réalisatrice lors de la cérémonie de remise de la Palme d’Or à Cannes m’avait passablement énervé. Quand on détourne les micros qui se tournent vers vous pour un autre usage, c’est de l’abus de confiance. Surtout quand on mord la main qui vous a aidée au travers des nombreuses subventions publiques à la création artistique. Il est vrai que l’élégance se perd…
Cela dit, la critique étant bonne, le bouche à oreille positif, j’ai bravé mes réticences. Au final, c’est un bon film, avec une forte densité du scénario et un cheminement de l’histoire parfaitement travaillé. J’ai lu que ce scénario avait été trituré, maturé et repris des dizaines de fois. Le résultat est là, le spectateur se laisse happer par l’histoire, dans un environnement de montagnes qui dépayse. L’ajout de la langue anglaise, dans de larges parties du film, participe à une certaine forme d’enfermement du spectateur, comme un miroir de la lutte de cette Anglaise obligée de se défendre dans une langue qui n’est pas la sienne.
La tension va crescendo, malgré le côté apaisant de l’avocat. Le procès s’ouvre pour juger une femme de meurtre, sans qu’on ait appréhendé la personnalité de la victime, le mari. Tout tourne autour de ce procès, et de l’attaque frontale du procureur contre une étrangère déboussolée. Les jeux sont-ils faits ?
Non. La réalisatrice montre de la compassion pour cette femme, et va la sortir de ce mauvais pas par quelques révélations. Le personnage du mari s’éclaire petit à petit. Il n’est pas reluisant. Un homme mal dans sa peau, jaloux des succès de son épouse. et surtout dépressif. A-t-il mis fin à ses jours ? Le procès donne lieu à des considérations intéressantes sur la création et l’écriture. Une grâce ou une peine selon le cas. Enfin arrive le point culminant, la dispute enregistrée et donc reprise en flash-back, entre les époux qui est d’autant plus percutante qu’elle s’opère sans hausse de voix excessive. Les deux amants affutent leurs griefs à coups de lames de rasoir. La scène est impressionnante de virtuosité. La femme s’y montre plus convaincante et le sentiment se retourne. Le jugement arrive bientôt, conforme aux attentes. La femme retourne à sa vie d’avant, avec son fils, et son avocat plus que complice.
Au-delà de l’histoire bien léchée, le message du film n’est pas très clair. C’est un peu fade, à mes yeux. Heureusement, il y a cette formidable scène de la dispute qui suinte d’authenticité. Reste que les acteurs sont falots. L’homme est hélas sans nuances, ce qui le condamne très vite. Quant à la femme, peut-être est-ce du à sa qualité d’étrangère maitrisant mal la langue française, elle est sans chaleur et laisse le spectateur indifférent à son sort. Je suis sûr qu’un autre choix d’acteurs aurait pu davantage porter le film. En créant un phénomène d’identification d’un côté ou de l’autre qui manque ici cruellement… Au final, une bonne Palme d’Or, mais un film imparfait qui ne mérite pas de donner à sa réalisatrice la tribune politique qu’elle s’est indécemment arrogée.