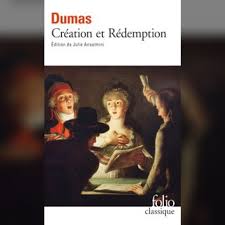
Ce n’est pas le meilleur roman de Dumas. Pas le plus connu non plus. Son titre malvenu est impossible à retenir. Et c’est un pavé qui pèse son poids sur la table de chevet, même en version poche. Ne le cachons pas, « Création et Rédemption » nécessite une petite dose d’abnégation pour s’attaquer à sa lecture.
On est très loin des « Trois Mousquetaires », et pourtant le style est toujours là. Cette dernière oeuvre d’un écrivain vieillissant reste directe, accessible, sans recherche de fioritures littéraires. Les détails nombreux campent bien le récit, et le lecteur se laisse séduire. A une réserve près : l’intrigue est simplette avec cette histoire de médecin altruiste découvrant une jeune fille souillon et quasi arriérée-mentale dans une cabane en forêt. Une jeune femme qu’il va essayer d’élever à une plus haute condition comme un pygmalion attentionné. Les sentiments vont bien sûr se mêler à l’affaire, même si la jeune fille est très jeune ( la minorité des filles n’était alors pas un problème ). Avant un double coup de tonnerre : le seigneur local déclare que c’est sa fille et il vient la récupérer. Le médecin qui réside à Argenton et est très apprécié par tous ses concitoyens, est appelé à devenir représentant de sa région berrichonne à la Convention. La révolution française s’agite. Nous sommes en 1792.
Le lecteur découvre très vite que l’intrigue est un prétexte. L’objet principal du roman est de raconter les hauts faits de la Révolution pendant les deux années décisives que furent 1792 et 1793. J’avoue que ce fut ce contexte historique qui m’a incité à attaquer ce roman. La Révolution, notre Révolution est finalement peu connue de nos contemporains, même si beaucoup s’y réfèrent en permanence, comme à un étalon-mètre de tout engagement politique. Pour ce faire, Dumas a bien étudié la période et s’appuie sur les commentaires éclairés du plus grand historien du siècle, Jules Michelet. Alexandre Dumas, dans ses vieux jours, s’attèle à faire connaître la Révolution à ses contemporains, et par la même occasion, à la postérité.
Nous voilà donc plongés dans les diatribes sans fin des conventionnaires, les luttes d’influence entre Girondins, Montagnards, Cordeliers, et autres Jacobins, les batailles de Valmy et de Jemmapes qui sauvèrent la Révolution de la menace étrangère… Le médecin de la Convention est sur tous les fronts et vit tous les grands moments de l’époque.
Dumas prend plaisir à raconter toutes les péripéties de cette Révolution, avec des préférences marquées pour la personnalité profonde de Danton. A l’inverse, les personnages de Marat, Saint Just, Robespierre ne sortent pas vraiment grandis. Il faut dire que tous ces révolutionnaires ne semblent motivés que par la prise de parole devant leurs pairs, des grands effets oratoires pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Avant que n’arrive la terreur en 1793 et l’usage systématique de la guillotine. Tous en seront victimes, les uns après les autres, dans un grand suicide collectif où la meilleure façon de se débarrasser des traitres est de tous les éradiquer. On s’interroge : c’est ce délire paranoïaque sanglant qui constitue les fondements de notre démocratie ? La chose fait peur…. La violence au nom des idées, et surtout de la plus grande pureté des unes par rapport aux autres paraît comme une vraie impasse. D’ailleurs, après l’exécution de Robespierre, la France retrouve une certaine sérénité. La Révolution est passée…
Le roman de Dumas retrouve son cours, avec une petite incertitude finale cousue de fil blanc entre ses deux protagonistes. Le lecteur a passé du temps dans l’atmosphère délétère de notre Histoire dans ses pages les plus sombres. Intéressant, bien qu’un peu lourd à digérer. La vénération de nos révolutionnaires ne semblent pas vraiment fondée. Pourquoi tant de haine entre des hommes qui avaient pourtant tous contribué à faire chuter la Royauté ?
